XVIIe siècle
-

En 1698 environ, Claude III Nivelon, disciple de Charles le Brun et "dessinateur" ordinaire du roi, s'apprêtait à faire publier la biographie de son maître, décédé depuis 1690, dont la réputation et la renommée semblaient alors sensiblement ternies. Pour des raisons inconnues, ce texte - indubitablement la source la plus importante sur l'art du premier peintre de Louis XIV - ne fut jamais publié. Le manuscrit original, disparu, fut transcrit au début du XIXe siècle dans des circonstances difficiles à éclaircir. Cette transcription , conservée à la Bibliothèque nationale de France, n'a jamais été éditée. L'édition critique de La vie de Charles Le Brun, élaborée par Lorenzo Pericolo, permet donc pour le première fois de consulter ce texte essentiel pour l'histoire de la production artistique en France au Grand Siècle.
Lorenzo Pericolo est maître de conférences à l'université de Haute Bretagne, Rennes 2. Il a aussi publié "Philippe, homme sage et vertueux". Essai sur l'art et l'oeuvre de Philippe de Champaigne: 1602-1674 (Tournai, 2002).
-

Philippe Quinault (1635-1688) fait représenter en novembre 1668 son avant-dernière tragédie, Pausanias, écrite à la hâte en sorte de combler une lacune dans le répertoire de la troupe de l’Hôtel de Bourgogne. Inspiré par l’Andromaque de Racine, créée un an auparavant, Pausanias n’en est néanmoins pas une répartie sommaire. Désavouant la tradition selon laquelle le théâtre serait une littérature d’élite, Quinault ambitionne de châtier quelques-unes des fautes qui auraient entaché l’ouvrage de son jeune rival. Ce faisant, il nous livre Démarate, héroïne furieuse et violente qui ourdit un dénouement inoubliable, et Cléonice, dernier rôle endossé par la célèbre Mademoiselle Du Parc qui avait aussi créé celui d’Andromaque pour Racine.
Le texte, établi et annoté par Edmund J. Campion, paraît pour la première fois depuis plus de deux siècles. Il est rehaussé d’une étude, par William Brooks, de la genèse, de la construction et du destin de cette tragédie dont la réputation a été arbitrairement flétrie.
-

L’étude d’Emmanuelle Hénin entend démontrer l’antériorité et la primauté d’une notion d’ut pictura theatrum sur celle, célébrée, de l’ut pictura poesis, bien que celle-là ait été arbitrairement considérée comme un phénomène secondaire. Il s’agit de montrer la cohérence et la continuité de cette conception de l’imitatio dramatique durant deux siècles, depuis la Renaissance italienne jusqu’à la «doctrine classique française », suivant une méthode à la fois théorique et historique, en consultant l’histoire de l’art, l’histoire du théâtre et l’esthétique. L’analogie entre les deux modes de représentation, quand bien même ils diffèrent par des moyens d’expression propres, se fonde sur une série de topoi sans cesse commentés, tant dans l’exégèse d’Aristote que dans les traités de théâtre et de peinture. Non un atticisme, pas plus qu’un ornement, ces lieux com
muns se trouvent convoqués dans tous les débats esthétiques sur l’idéalisme, la distinction des genres, la règle des trois unités, la rhétorique des passions, le jeu de l’acteur, etc., que cette nouvelle histoire de l’ut pictura theatrum éclaire d’une lumière inédite.
-

Composée de quelque mille sept cents formes fixes – clichés idiomatiques, phraséologismes et proverbes – émanant d’une source inconnue, la Comédie des proverbes est une plaisanterie dramatique et littéraire. En dépit des contraintes de son lexique, elle présente une fable cohérente en trois actes tout en esquissant des caractères véritables et elle respecte les unités dites classiques à une époque où leur introduction était encore débattue. Quoique faite pour la scène, on ignore si elle a jamais été jouée. À peine remarquée par ses contemporains, elle a pourtant connu un succès commercial prolongé avec de nombreuses rééditions. Anonyme, bien que traditionnellement attribuée au guerrier littérateur que fut Adrian de Montluc, comte de Carmain, composée à une date indéterminée, sans doute vers 1630, la Comédie des proverbes se dérobe et apparaît comme un phénomène unique en son genre: résultant d’une expérience linguistique autant que théâtrale, elle nous dispense un jeu d’érudition et d’adresse de l’esprit, amusant et édifiant à la fois.
-
L’opéra français de Quinault, Lully et leurs successeurs n’est pas un simple divertissement: comme pour toute forme d’art, les œuvres rassemblées dans le Recueil général des opéras expriment une certaine vision de l’homme dans ses rapports au monde et au divin. Ainsi, sur le plan moral, doivent-ils beaucoup à la tradition épicurienne. Cependant, cet épicurisme est modulé et il évolue, un moment tenté par un hédonisme facile, puis cherchant à réconcilier bonheur et vertu. La mise en question des dieux, déjà présente du temps de Lully, s’exacerbe par la suite tandis que l’homme se pose en victime. Toutefois, après 1713, le principe divin est progressivement réhabilité. Paradoxalement, il ressort de cette évolution qu’à l’Opéra, c’est sous le règne de Louis XIV que se développent les contestations les plus radicales, et que le Siècle des Lumières est aussi celui de la remise en ordre sur le plan moral et théologique.
-
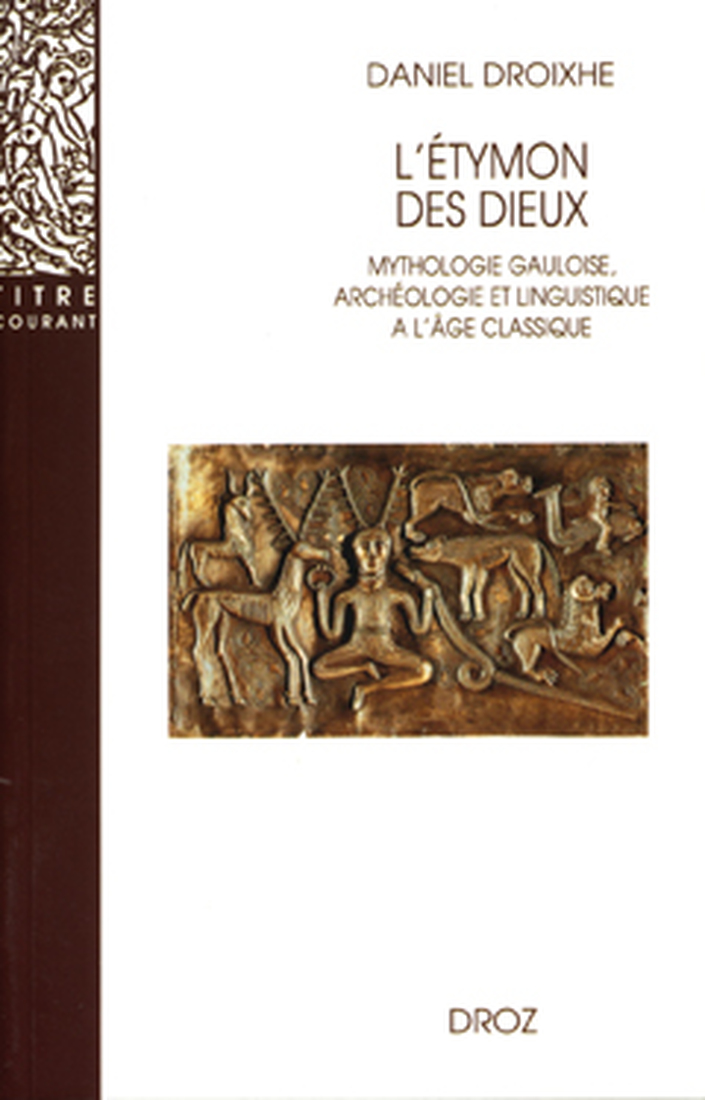
En 1548, des voyageurs flamands visitant à Venise le Musée Grimani relèvent le nom du dieu Belenus. Cet " Apollon gaulois " ne tarde pas à éprouver la sagacité de quelques-uns des meilleurs spécialistes en matière de langues et d’antiquités : Joseph Scaliger, Camden, Saumaise, Vossius, Spon, comme Reinesius. Le 5 janvier 1647, la violente tempête qui fait refluer les eaux du rivage de Domburg, en Zélande, dégage plusieurs autels dédiés à Nehalennia, une divinité celtique inconnue. Celle-ci excite aussitôt les spéculations étymologiques et l’enquête fournit l’occasion de formuler, pour la première fois avec l’acuité méthodologique qui la caractérisera au XIXe siècle, la théorie de l’origine commune des langues européennes, de l’Atlantique à la mer Noire. Une troisième découverte archéologique, l’exhumation, le 16 mars 1711, du pilier des nautes parisiens consacre le panthéon gaulois en faisant surgir les figures de Cernunnos, de Hesus ainsi que du taureau à trois grues.
Aux origines de la linguistique moderne se dégagent ainsi une restitution de l’archive, un affranchissement de l’oralité par rapport à l’inscription, une prise de conscience de la force créatrice et sociale du langage qui anticipe les conceptions de Vico ou Herder. Simultanément, le travail archéologique évolue de la collection et de la citation littéraire à " l’invention de la préhistoire " et, partant, à la description d’une matière émancipée du texte. Aussi Daniel Droixhe s’emploie-t-il à saisir la mutation de deux disciplines, l’archéologie et la linguistique, confrontées à des écoles ou à des épisodes majeurs de l’historiographie européenne : la quête de l’origine grecque, l’exaltation des antiquités germaniques, la crise des amusements d’antiquaire, le recyclage – déiste ou chrétien – du druidisme et le triomphe " éclairé " de la celtomanie, entre primitivisme et genèse de l’anthropologie.
-
Un corpus, méconnu et volumineux, est au cœur de ce livre : celui que composent les écrits "micrologiques" peignant les mœurs des érudits et principalement issus de l’université allemande des XVIIe et XVIIIe siècles. L’auteur, en confrontant le lecteur à l’immédiateté d’une matière textuelle singulière et redondante, s’interroge, non sans ironie, sur la nature et le contenu de ces bagatelles, qui aussi subtilement que mécaniquement dessinèrent en leur temps la voie d’une autre philosophie, parallèle et fallacieusement mineure. L’effet de loupe, revendiqué ici avec malice, est l’occasion d’une remise en cause des catégories traditionnelles dans lesquelles s’enferme parfois la réflexion : le temps, l’espace, le nombre, la vérité, le discours, le sens, la langue, la notion d’auteur et jusqu’à celle de pensée. L’ensemble, qui à tout moment joue avec l’ambiguïté du paradoxe, est à lire comme une expérience à tenter.
-
-
-
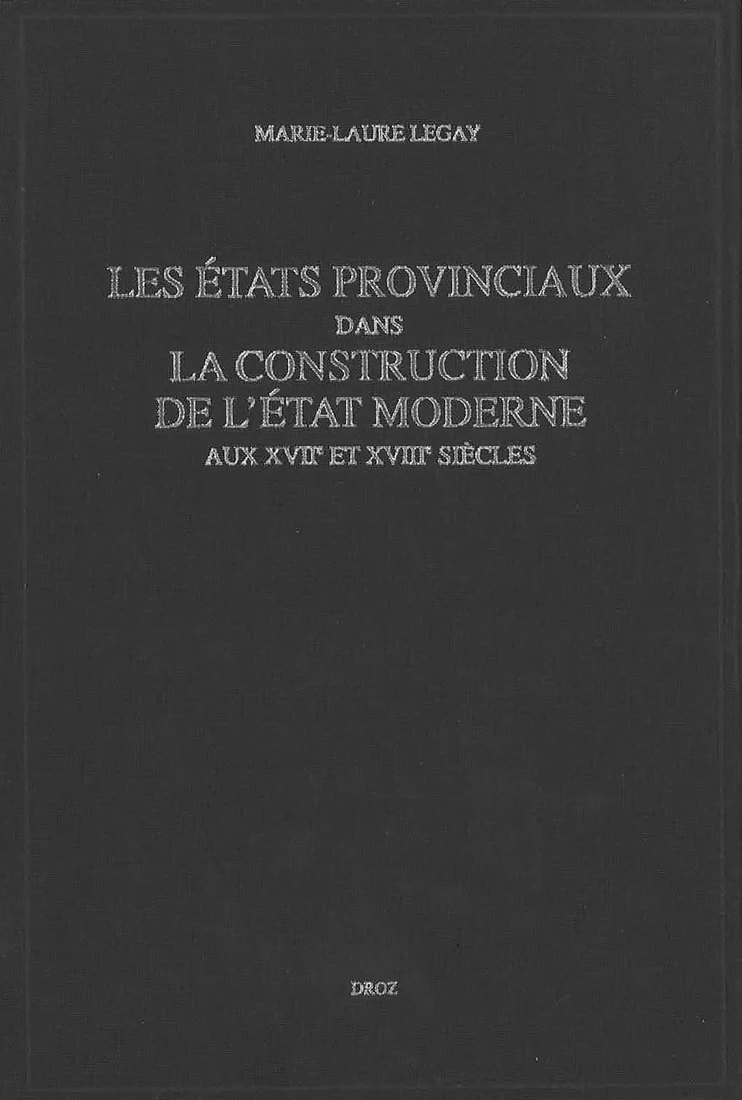
Cette enquête sur les Etats provinciaux rompt avec l’historiographie traditionnelle et réévalue l’idée selon laquelle ils n’auraient plus constitué au XVIIIe siècle que des bras morts de l’administration française. C’est bien au contraire à cette époque que Marie-Laure Legay discerne un développement inédit des attributions des Etats provinciaux. Le paradoxe que constitue l’existence d’assemblées politiques revivifiées dans une monarchie de plus en plus centralisée se vérifie pour les provinces septentrionales (Artois, Cambrésis, Flandre wallonne), objet principal de la thèse, mais également pour l’ensemble du royaume (Béarn, Bourgogne, Bretagne, Languedoc…). Leur regain d’activité fut favorisé par l’évolution des relations des Etats provinciaux avec l’Etat royal : par nécessité, la monarchie en vint à nouer avec leurs oligarchies un contrat tacite d’attribution exclusive du pouvoir provincial, reléguant l’intendant dans un rôle mineur, en échange d’une application des directives centrales dans le pays. De leur côté, les Etats provinciaux abandonnèrent leur rôle traditionnel de protecteurs des libertés provinciales, pour devenir de redoutables administrateurs, renforçant les mesures de contraintes fiscales et juridictionnelles sur les habitants. L’auteur montre en outre que cette évolution fut orchestrée conjointement par les députés provinciaux et les bureaux ministériels qui entretenaient d’étroites relations, notamment grâce à la représentation permanente de certains Etats à Paris. C’est seulement à la fin de l’Ancien Régime que fut vivement dénoncée l’émergence de la puissance " co-active " des Etats, indice de la profonde mutation qu’avait alors subi leur rôle.